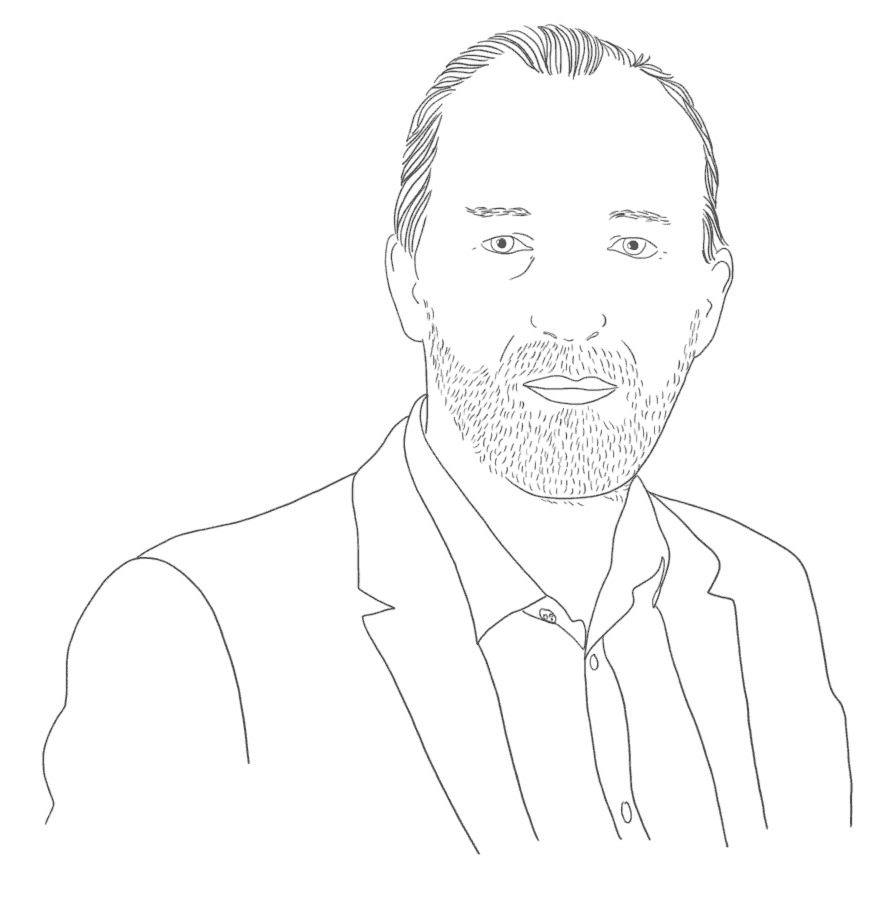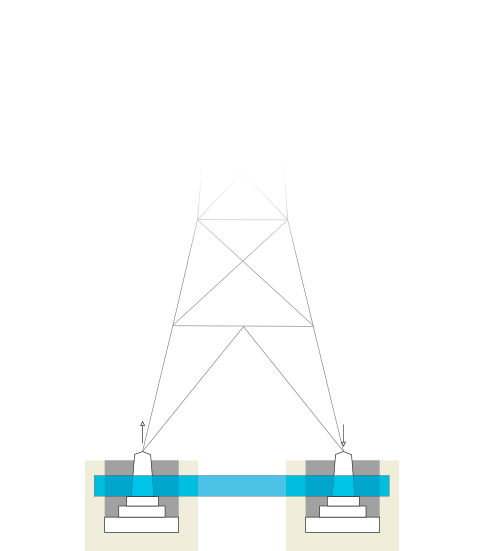Le retour d’expérience des travaux menés au cours des premières années, les évolutions de réglementation, les événements météorologiques – les épisodes de vent en particulier – auxquels les ouvrages déjà sécurisés ont été exposés et les études d’optimisation du CNER vont faire évoluer les choses. Il en va de même des innovations émanant des opérationnels sur le terrain, des fournisseurs et des experts.
Les pilotes stratégiques
de la sécurisation mécanique
- Jean-Michel Bigi (Jusqu'en 2007)
- Olivier Grabette (Jusqu'en 2011)
- Stéphane Duburcq (Jusqu'en 2014)
- Isabelle Debaudringhien (Jusqu'en 2016)
- Phillipe Strada (Jusqu'en 2017)